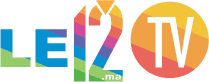Le but de cette déformation était de remettre en cause les liens religieux et politiques entre les tribus du Sahara et le pouvoir central marocain.
Par- Younes Mjahed
Les seuls articles de presse ne sauraient suffire à analyser et à réfuter les thèses non scientifiques avancées par une frange de la gauche européenne, dans son soutien au plan de l’Espagne franquiste et de l’Algérie dans le cadre de l’affaire du Sahara marocain.
Tout chercheur scientifique qui se respecte peut mener une étude approfondie en se référant aux archives marocaines, espagnoles et françaises.
Il y trouvera des preuves tangibles à même de démasquer les allégations des adversaires de l’intégrité territoriale du Maroc.
Personnellement, j’ai expérimenté une autre approche qui s’est avérée probante : l’analyse des écrits de ceux qui tentent de défendre scientifiquement ce plan.
Mes lectures m’ont conduit à une conclusion diamétralement opposée à leurs assertions, ce que j’ai nommé le raisonnement par l’absurde.
Ce raisonnement, emprunté à la logique mathématique, consiste à prouver la véracité d’une proposition en démontrant la fausseté de son contraire. Parmi les textes soumis à cette approche figure une conférence dite « scientifique », organisée par la Ligue française des droits de l’homme à Massy, en banlieue parisienne, les 1er et 2 avril 1978.
Les actes de cette conférence, publiés sous le titre «Sahara occidental, un peuple et ses droits», réunissaient des professeurs de sciences humaines de la gauche française, qui s’étaient donné deux jours pour définir l’identité du «peuple sahraoui».
Un sociologue, Francis de Chassey, fut invité à présenter le contexte géographique, historique et sociologique du sujet.
Il débuta son intervention en avertissant que nombre d’affirmations et de jugements, présentés dans le cadre de la « lutte du peuple sahraoui pour l’autodétermination », étaient préétablis, arguant du fait qu’»il n’est pas de problématique sans idées préconçues, implicites ou explicites soient-elles ».
C’était la première fois que j’observais une problématique aboutir à des conclusions prédéterminées, sans le moindre effort de recherche ou d’analyse.
Évoquant la région qu’il étudiait, à savoir le «Sahara occidental», ce professeur la désignait comme les terres de la «République arabe sahraouie démocratique».
Le même professeur poursuivit sa présentation «scientifique» en décrivant la structure tribale du Sahara.
Il cita le concept de asabiyya d’Ibn Khaldoun, mais le dénatura complètement, affirmant : «Il faut un minimum d’asabiyya pour que la tribu soit stable, se considérant comme responsable et héritière de la nation arabo-musulmane, directement, sans médiation spirituelle ou temporelle». Le but de cette déformation était de remettre en cause les liens religieux et politiques entre les tribus du Sahara et le pouvoir central marocain.
Pour rappel, l’asabiyya chez Ibn Khaldoun désigne la solidarité, la défense et la fierté d’appartenance à la tribu, et non la responsabilité de la nation arabo-musulmane.
Ce n’est là qu’un exemple, car toutes les interventions de cette conférence regorgeaient de jugements erronés sur la société marocaine et les tribus sahraouies, tant sur le plan historique que sociologique. Les conférenciers s’évertuèrent à définir les caractéristiques du «peuple sahraoui», telles que la langue hassanie, la «siba» (dissidence), la «djemaa» (assemblée) et «Aït Arbaïn» (conseil des Quarante), présentées comme des organisations spécifiques, alors que tout étudiant en sociologie au Maroc sait qu’elles sont omniprésentes dans la région, en particulier au sein des tribus marocaines.
Les mêmes erreurs naïves furent commises par les professeurs de gauche, qui s’accordèrent sur l’idée que le contrôle administratif et militaire du territoire était la preuve de la souveraineté, un concept propre au droit occidental, inapplicable à l’expérience marocaine, où la souveraineté reposait principalement sur la population, non seulement au Sahara, mais aussi dans les périphéries des capitales, comme Marrakech, Fès, Meknès et Rabat, où les relations avec le pouvoir central fluctuaient selon les contextes et les circonstances, sans jamais renier les liens de souveraineté.
Cette conférence fut érigée en dogme par la gauche française, à l’instar du livre du Mauritanien Ahmed-Baba Miské, « Front Polisario, l’âme d’un peuple », publié en 1978, qui déformait l’histoire de la région et se complaisait dans le dénigrement de l’armée de libération marocaine.
Miské reconnaissait que «des dizaines de Mauritaniens et de Sahraouis» avaient rejoint cette armée, qui avait libéré une grande partie du Sahara, avant d’être attaquée par les forces franco-espagnoles, «qui l’ont réduite en miettes», selon ses termes.
Miské, ancien dirigeant du Polisario, adoptait la thèse occidentale, considérant qu’« un nouveau patriotisme, créé par le colonialisme, oblige à accepter les frontières tracées par le colonisateur ».
Il affirmait également que «les étrangers ne comprennent pas la question de l’unité territoriale historique». Quant à l’avis de la Cour internationale de justice, il prétendait qu’il reconnaissait des liens entre les peuples de quatre pays frontaliers, sans reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara, ni l’existence de relations administratives avec sa population. La conclusion de Miské, dans sa quête de l’identité du «peuple sahraoui», était pour le moins surprenante : « Le Sahraoui est habitué depuis son plus jeune âge aux raids, et quand il tue son ennemi, il fait pousser une mèche de cheveux sur sa tête, appelée le ‘’qarn’’ (touffe) ». N’êtes-vous pas d’accord avec moi sur la pertinence de la démonstration par l’absurde?.
*Journaliste, président de la commission provisoire chargée de la gestion de la presse et de l’édition.
Source: Maroc -heddo