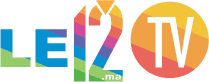L’essor des nouvelles technologies a bouleversé le paysage médiatique, posant des défis majeurs à l’éthique journalistique.
Si la majorité écrasante des professionnels reconnaissent l’importance des organes d’autorégulation et respectent leurs rappels à l’ordre, certains remettent en question leur légitimité et refusent de se soumettre à leurs décisions.
Par- Younes Mjahed
La presse marocaine est confrontée à un défi majeur, exacerbé par l’essor exponentiel des nouvelles technologies de la communication.
Celles-ci ont créé, certes, d’innombrables opportunités, mais elles ont également favorisé l’émergence de pratiques nuisibles, telles que la diffamation, le chantage et la recherche du sensationnalisme notamment par des gens qui se proclament journalistes du jour au lendemain, au détriment de l’éthique professionnelle.
Bien entendu, ces dérives ne sont pas propres au journalisme.
De nombreuses professions se sont organisées en structures pour se protéger et instaurer des règles déontologiques inviolables.
Le sociologue Émile Durkheim soulignait déjà dans « De la division du travail social » (1893) que la liberté individuelle ne saurait s’opposer aux règles organisationnelles, mais en découle.
Cette réalité s’observe également dans l’histoire du Maroc, où les métiers étaient traditionnellement organisés avec des règles professionnelles et éthiques, jalousement supervisées par des syndics (Oumanâ’ al hiraf) .
Le journalisme n’a pas fait exception à cette règle. Dès qu’il est devenu une profession à part entière, il s’est doté d’organisations professionnelles et de chartes éthiques, piliers de son exercice libre et responsable.
Dans de nombreux pays démocratiques, ces organisations professionnelles ont institué des tribunaux d’honneur, des instances dirigées par les pairs qui statuent sur les cas de manquement à l’éthique journalistique.
À travers le monde, des dizaines de conseils de déontologie publient chaque semaine des décisions à l’encontre d’institutions médiatiques et de journalistes.
Ces décisions sont généralement respectées, car émanant d’une autorité professionnelle et morale dont la vocation est l’éthique, et non la sanction.
Il est rare que les institutions médiatiques ou les journalistes visés se rebellent contre les organes d’autorégulation, s’en prennent à leurs membres, ou divulguent leur correspondance pour susciter la sympathie ou se victimiser.

Au contraire, ces décisions sont accueillies avec respect, perçues comme un rappel à l’ordre éthique au sein de la profession, cette «famille» dont parlait Durkheim.
Au Maroc, il est tout aussi inhabituel de voir des avocats, des juges, des médecins, des pharmaciens, ou d’autres professionnels contester les décisions de leurs instances ordinales.
La situation est similaire dans la presse marocaine, où des dizaines d’institutions et de journalistes ont été interpellés, et de nombreuses décisions ont été rendues par l’organe d’autorégulation (le Conseil national de la presse), sans susciter de contestation.
Seule une poignée d’individus, marginale, a choisi la voie de la victimisation et de l’attaque personnelle contre les membres de cette institution, ne se sentant pas véritablement appartenir à cette «famille» professionnelle.
Décidément, certains individus ne peuvent se permettre de changer leurs ‘’habitudes’’, car ils en dépendent pour leur subsistance.
C’est un point qu’a soulevé le sociologue Pierre Bourdieu lors d’une conférence à l’École supérieure de journalisme de Lille en 1996.
Il y soulignait la nécessité de considérer les conditions socio-économiques, tant favorables que défavorables, dans la pratique de l’éthique.
Pour que les comportements éthiques prônés se respectent, il ne suffit pas de les recommander.
Il faut créer un environnement économique et social propice à leur application.
L’analyse de Bourdieu est pertinente, mais il convient de distinguer deux attitudes. D’une part, ceux qui luttent contre la précarité par le travail, la persévérance et l’engagement syndical.
Et de l’autre, ceux qui exploitent les nouvelles technologies pour rechercher à tout prix le nombre de vues et de clics, qu’ils quémandent ouvertement, sans égard pour les principes éthiques et déontologiques.
Ce que Bourdieu considérait, dans tous ses écrits sur le journalisme et les médias, comme un véritable fléau.
* Journaliste, président de la commission provisoire chargée de la gestion de la presse et de l’édition.
Source : Maroc- Hebdo